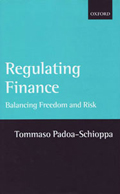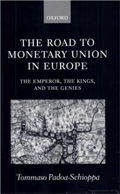La Francia ritrovi la sua leadership in Europa
Président de Notre Europe, Tommaso Padoa-Schioppa est ancien ministre de l’Economie et des Finances italien.
La France hérite de la présidence de l’Union au moment où les opinions publiques expriment défiance ou lassitude envers l’Europe. Les citoyens réclament une autre Europe ou moins d’Europe ?
L’opinion publique est une notion difficile àcerner et si facile àmanipuler que chacun est tenté de l’utiliser àson profit : Il faut résister àcette tentation . Avant même le ” non ” irlandais, si l’on fait la somme des “oui” et des “non” dans les pays où s’est déroulé un référendum sur le traité constitutionnel en 2005 – l’Espagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas -, le “oui” est majoritaire ! Les sondages eurobaromètres montrent que dans leur majorité, les Européens veulent une Défense commune et plus d’Europe dans toute une série de domaines. Mais si l’Europe leur est présentée par desgouvernement frileux, et dans un langage incompréhensible, les gens disent non. La question n’est pas “combien d’Europe”, mais “comment l’Europe ?”.
On peut d’ailleurs contester l’utilisation même du référendum, obligatoire en Irlande, interdit en Alle-magne et en Italie, facultatif en France et aux Pays-Bas. Les Allemands ont compris qu’il s’agit d’une forme dangereuse d’exercice de la démocratie depuis qu’Hitler s’en est servi pour consolider son pouvoir. En Italie il est exclu par la Constitution dans le domaine fiscal et les traités internationaux ce qui àmon sens une mesure de sagesse. En France et aux Pays Bas, le référendum a constitué une abdication de leur responsabilité par les gouvernements en place.
Il n’y a donc pas de malaise entre les citoyens et l’Union européenne ?
Je ne nie pas ce malaise. Mais je m’interroge. Ce fossé est il plus profond qu’il y a trente ans ? je ne le crois pas. Il a une composante nationale très forte. Et il est entretenu et encouragé par la classe poli-tique. L’Union européenne a une telle force, une telle crédibilité que les gouvernements ont cru pouvoir lui mettre sur le dos toutes les décisions impopulaires. C’est une énorme myopie politique et un phénomène grave qui a aggravé un sentiment de défiance des opinions publiques sur laquelle les souverainistes et les eurosceptiques ont beaucoup investi.
Mais àl’heure actuelle, le “parler vrai” rapporte beaucoup plus qu’il ne coûte. La mauvaise humeur des opinions publiques est aussi une réaction au “parler faux”.
Nicolas Sarkozy se veut un adepte du parler vrai. Cette méthode peut-elle porter des fruits au niveau européen ?
L’expérience a montré que la politique européenne d’un pays ne se définit pas forcément lors de sa présidence. Le rôle historique des présidents français dans la construction européenne n’a pas été spécialement lié aux semestres de présidence de l’Union, qu’il s’agisse de Valéry Giscard d’Estaing ou de François Mitterrand. La France a ou pourrait avoir un rôle de leadership européen quelque soit sa position dans les séquences de présidence.
Le style même du président français depuis un an, est-il de bonne augure ?
Aucun pays n’est aussi décisif pour l’avenir de l’Europe que la France. Cela reste aussi vrai que dans les années cinquante. La France a inventé la formule européenne, l’a fait avancer et, périodiquement, l’a bloqué. C’est le seul pays qui ne puisse être clairement classé parmi les pro-européen ou les eurosceptiques. En Italie en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Autriche existe une très large majorité européenne qui transcende les clivages politiques. A l’opposé, le Royaume-uni est, en majorité eurosceptique. En France les deux camps existent sur tout l’échiquier politique. Ce pays a tendu la main àl’Allemagne, lui a proposé de partager l’acier et le charbon cinq ans après la fin de la guerre. Mais c’est aussi celui qui refuse la décision àla majorité sur les taux de TVA…En fait, le leadership français n’a plus été exercé depuis Maastricht. Pour qu’elle l’exerce ànouveau, il faut, àmon avis, abandonner cette idéologie française de l’unanimité et du veto, et passer àla majorité.
Comment la France peut-elle rompre avec cette idéologie ?
Il y a mille manière de décliner l’abandon du mythe du veto et de l’unanimité. L’une est de recourir àl’avant garde, qui est àl’origine même de la construction européenne : àla Conférence de Messine, en 1955, quand on a jeté les bases du traité de Rome, la Grande-Bretagne a décidé de quitter la conférence et les autres ont décidé d’aller de l’avant. Schengen, le SME, l’euro sont autant d’exemple d’avant gardes. Aujourd’hui, c’est la seule chance de faire avancer l’Europe.
Vous pensez que si la France proposait une avant garde ou une coopération renforcée sur cer-tains sujets, elle serait suivie ?
L’art du leadership consiste justement àtrouver le bon projet, àconvaincre, et àformer un noyau àquelques uns tout en laissant la porte ouverte aux autres. C’est l’inverse d’un directoire, dont les portes sont fermées.
Les priorités de la présidence pourraient-elles servir de base àde telles avancées ?
Il faut distinguer entre la tâche de toutes les présidences, faire avancer et aboutir des dossiers qui sont dans l’engrenage du calendrier européen, et celle qui consiste àproposer des projets novateurs.
Dans quels domaines ces projets pourraient-ils voir le jour ?
Dans le programme français, il y existe par exemple, un projet de régulation et de supervision du sys-tème financier européen. Actuellement, le système est doublement pénalisant. Une première fois en raison du surcoût de la régulation provenant de l’absence de régulation uniforme entre les 27 pays membres, en dépit de directives communes. Et une deuxième fois par la perte d’efficacité provoquée par cette fragmentation, en terme de transparence et de stabilité, qui sont le but même de la régulation. L’accord Bâle 2 s’est ainsi traduit par des obligations très différentes d’un pays àl’autre. Il y a autant d’interprétations de la directive que d’Etats membres. Un groupe bancaire qui opère dans 15 pays doit dans chacune de ses filiales obéir àune version différente de Bâle 2. Peut-on y remédier à27 ? Probablement pas. Pourquoi ne pas laisser ceux qui le souhaitent aller de l’avant ? On peut trouver des exemples similaires dans l’énergie, la recherche, la politique étrangère.
Les priorités de la présidence française – l’immigration, l’énergie, la PAC – répondent-elles aux préoccupations des citoyens ?
Cet agenda est dicté en grande partie par la réalité. Sur nombre de sujets une solution exclusivement nationale est devenue une non-solution et passe par une dimension européenne voire mondiale pour le réchauffement climatique. C’est cette tension entre les promesses nationales et des réponses dépassant ce cadre qui explique les difficultés àtrouver un accord àBruxelles.
Si l’on en juge par les critiques qui fusent actuellement l’Europe est ressentie comme trop li-bérale et pas assez sociale. Qu’en pensez-vous ?
Il suffit de lire le traité de Rome pour voir que le social a été fortement présent, dès le début, même si cela n’a peut-être pas été assez affiché. Et même dans le monde ouvert d’aujourd’hui, on ne peut affirmer que la compétitivité et le social ne sont pas compatible. Il suffit de regarder la Suède la Finlande, le Danemark. Une bonne partie des pays qui réussissent le mieux aujourd’hui sont fortement marqués par le social, plus encore que la France et l’Italie. La question centrale est de savoir si l’on veut que le social devienne une compétence de l’Union ou reste une compétence nationale. A mon avis, les instances de sécurité sociale ne gagneraient pas àun transfert massif. On ne peut, par exemple, imaginer un salaire minimum européen, car les situations sont trop différentes entre les pays membres. La Bulgarie ou la Roumanie doivent pouvoir profiter aujourd’hui de bas salaires comme l’Italie l’a fait dans les années cinquante, avant de voir leur revenus s’améliorer.
Propos recueillis par Catherine Chatignoux et Françoise Crouïgneau